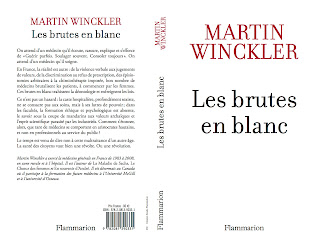A celles et ceux qui aspirent
à soigner
1° Le « corps médical »
n’existe pas
Cette
affirmation peut surprendre (et hérisser certains). Elle n’en est pas moins
confirmée par les faits.
S’il
s’agit simplement de désigner l’ensemble des personnes ayant un diplôme de
docteur en médecine – ou qui exercent les fonctions de médecin, ce qui n’est
pas la même chose – l’expression peut suffire. Mais elle n’a pas grande
signification. Pas plus que quand on parle du « corps enseignant » ou
du « barreau » pour désigner les avocats.
De
même qu’il existe un monde entre une institutrice de classe primaire et un professeur
d’université, il y a un monde entre les modes d’exercice, les statuts et les
attitudes des médecins. J’ai exercé pendant vingt-cinq ans comme vacataire dans
un centre d’IVG et un centre de planification hospitaliers, où je me suis
occupé de santé des femmes ; ma pratique, mon attitude, mon statut et mes
revenus n’avaient rien à voir avec ceux des gynécologues de ville (qui
pourtant, auraient dû faire le même travail que moi) et encore moins avec ceux
de tel professeur de gynécologie d’une grande fac de l’Est (aujourd'hui président du CNGOF) qui me demanda un
jour sans rire, après une de mes conférences (à un congrès de l'ANCIC, dans le Sud-Ouest), « Sur quelles études te
fondes-tu pour affirmer qu’on peut poser des DIU à des nullipares ? ».
C’était en 2004, je crois ; il ne devait pas encore avoir l’internet. Ni
être abonné aux publications (gratuites et disponibles en plusieurs langues) de
l’OMS sur la contraception. Je lui ai envoyé les références par courriel.
Peut-on
sans mauvaise foi prétendre que le ou la généraliste exerçant dans une campagne
en voie de désertification médicale ou dans une ZUP à la population sinistrée fait
le même métier que celui qui choisit de poser sa plaque dans une ville balnéaire
du Sud-Est ?
Et
peut-on vraiment affirmer que le
« cardiologue de famille » qui exerce à Orléans fait le même métier
que le spécialiste hospitalier ayant des parts dans une des cliniques les plus
cotées de Montpellier ?
Parler
du « corps » médical, c’est désigner un ensemble d’individus
extrêmement hétérogène, aux privilèges et aux intérêts très différents.
Parfois, radicalement opposés.
2° Etre médecin, c’est être un
privilègié
D’abord,
réglons cette question une fois pour toutes : être médecin c’est être un
privilégié. Et cela, sans même avoir
besoin de voir le moindre patient.
Etre
médecin permet de se soigner et de soigner sa famille. Quand on sait que
l’immense majorité des consultations courantes concernent des problèmes de la
vie quotidienne, c’est un privilège considérable de ne pas avoir à demander à
un tiers de confirmer que son enfant a une otite et pas une méningite, que son
conjoint a une douleur intercostale et pas un infarctus, que sa compagne a une
colique néphrétique et pas une grossesse extra-utérine.
Ce
premier privilège (savoir ce qui se passe, et si c’est grave ou non) se double
d’un second privilège (prescrire des médicaments et des examens
complémentaires) : le simple fait d’être (en principe) mieux informé que
le citoyen lambda quant à l’efficacité réelle d’un traitement est un privilège
dont on n’a pas seulement commencé à mesurer l’impact sur la vie d’un individu.
Troisième privilège : savoir qui appeler et comment accéder à des radios, à une
consultation spécialisée, à une hospitalisation. Pas toujours très facilement, mais plus facilement que le commun des mortels,
« confraternité » oblige.
Ces
privilèges et les prérogatives qui en découlent ont toujours fait des médecins
dans leur ensemble des professionnels très courtisés par les riches (qui
pouvaient autrefois acheter un avortement « propre » ou, aujourd’hui,
un traitement « pas encore sur le marché ») et par les marchands –
qui font tout leur possible pour les inciter à prescrire leurs produits ou les
commander pour l’établissement dans lequel ils exercent. Les banquiers aussi aiment bien les médecins : la souffrance humaine, inépuisable, est la meilleure caution d'un emprunt professionnel.
Le
savoir des médecins est, bien sûr, ce qui leur permet de faire leur métier.
Il
est parfaitement compréhensible qu’ils en usent pour eux-mêmes et leurs
proches. Mais en dehors de cet usage bien ordonné, est-il acceptable qu’ils le
gardent jalousement pour eux, ou qu’ils en usent de manière
discrétionnaire ? L’une des manifestations les plus flagrantes de
l’enfermement de la communauté médicale française est l’absence, jusqu’à une
période toute récente, de documents d’information conçus par les syndicats,
l’ordre des médecins ou les praticiens eux-mêmes à l’intention du public. Un seul exemple (mais il est
représentatif) : alors que les livres pratiques sur la contraception
existent en Angleterre depuis le début des années cinquante, et aux Etats-Unis
depuis la décennie suivante, le premier ouvrage français quasi-exhaustif sur la
contraception destiné au grand public date d'Octobre 2001. Et c’est un
généraliste isolé qui l’a écrit ; non le syndicat des gynécologues
obstétriciens français, pourtant parfaitement équipé pour le faire.


Ce
silence à l’égard du public, qui n’a été rompu que récemment – grâce à l'internet et sous la
pression du public, d’ailleurs – que dit-il de la culture des structures de
formation ? Comment se fait-il qu’on n’enseigne pas aux étudiants à
partager le savoir avec les premiers intéressés ? Le savoir, on peut le
partager sans le perdre. Ce n’est pas un lingot d’or. Ce que je sais, je peux
le transmettre sans cesser de le savoir. Pourquoi
refuser de partager le savoir sur la santé, sinon parce qu’on a conscience du
privilège qu’il représente ?
3° Même s’ils sont tous des
privilégiés, tous les médecins ne sont pas égaux
Tous
les médecins ne « capitalisent » pas leurs privilèges de la même
manière car le système veille à les trier. Il suffit en effet de regarder de
près le fonctionnement des hôpitaux pour constater que tous les médecins n’y
sont pas égaux, aussi bien dans les CHU que dans les hôpitaux de région. Le
traitement subi par les étudiants en médecine et résidents, en particulier
quand ils sont étrangers, a tout de l’exploitation.
Le plus grave est qu’on justifie cette exploitation par la « nécessité d’apprendre », et que beaucoup parmi ces exploités la considèrent comme « normale » ce qui entrave toute révolte susceptible de reformer le système. Si la formation médicale est élitiste et violente en France, c’est bien parce que son objectif profond vise à séparer « le bon grain de l’ivraie », les « cadors » des « médiocres », les spécialistes de pointe des généralistes de quartier.
4° Aristocrates de cour et hobereaux
4° Aristocrates de cour et hobereaux
A
leurs privilèges initiaux certains médecins en ajoutent d’autres. Car plus un
médecin est « en vue » (ou occupe un poste de responsabilité
important), plus il fera l’objet de demandes… et de propositions. En CHU, la
« carrière » des internes, des chefs de clinique et des agrégés
repose sur un système de cooptation clairement affiché et jamais remis en cause
par les pouvoirs publics, ce qui assure aux mandarins en place de ne travailler
qu’avec les praticiens qu’ils agréent. Ceux qui ne sont vraiment pas « à
leur place » peuvent se voir poussés vers la sortie par un harcèlement
violent – voire contraints à se jeter par la fenêtre.
Parmi
les membres de la profession médicale, on retrouve la même distribution hiérarchique
que dans l’Ancien Régime ; dès l'entrée en médecine, les PUPH se présentent aux étudiants comme de véritables aristocrates de cour (même s'il s'agit d'une cour de province) et leur décrivent les généralistes (quasi-absents de l'enseignement) comme appartenant à une "petite noblesse" assez méprisable, tant sur le plan statutaire
que sur celui de son importance dans le système de santé. Les généralistes sont présentés comme des exécutants un peu frustes, qui auront toujours besoin de la
parole éclairée du professeur de CHU (ou de ses élèves) pour savoir comment
exercer leur métier correctement. Plus tard, ce mépris vertical se manifestera
dans les échanges de correspondance et les pratiques de « captation »
de patients auxquelles s’adonnent nombre de spécialistes ou d’hospitaliers
(Non, non pas tous, mais aucun ne
devrait s’y adonner !)
Du
fait même de cette hiérarchisation, il est encore plus manifeste qu’il n’existe
pas « un » corps médical, mais des groupes d’individus qui se différencient
non seulement par leur statut (leurs liens plus ou moins
étroits avec l’université, par exemple) mais aussi par leur attitude vis-à-vis
de la délivrance des soins.
5° Soigner tout le monde, c’est
difficile
En
principe (et la plupart des professionnels ne le démentiront pas) on devient
médecin pour améliorer le niveau de santé de la population en général, et des
patients qu’on croise en particulier. Autrement dit, on devient médecin pour soigner.
Et
c’est bien là le problème. Car soigner, c’est l’opposé d’un privilège. C’est une activité altruiste, tournée vers
l’autre, qui demande un investissement intellectuel, physique, émotionnel et
moral considérable. C’est une attitude d’entraide et de partage. Quand on veut
le faire bien, soigner est difficile. Gratifiant, intéressant voire passionnant
et émouvant, sans aucun doute. Mais aussi frustrant, déprimant, éprouvant et
souvent épuisant. Et (quand on est généraliste, par exemple, ou spécialiste de
quartier) on ne sait jamais de quoi la journée sera faite. Quand on travaille dans
un centre de long séjour ou un service de chirurgie lourde, on ne le sait pas
non plus. Parfois, tout « roule ». Et parfois – plus souvent qu’on ne
le voudrait – on a le sentiment que les catastrophes s’empilent. Et quand elles
s’empilent, les médecins de première ligne, qu’ils soient généralistes de
campagne ou anesthésistes d’un service de chirurgie générale, se retrouvent
souvent seuls.
Car
il n’est pas seulement difficile de soigner, il est aussi très difficile de
soigner tous les patients qui se
présentent. Surtout quand on n’y a pas été formé.
La
médecine hospitalo-universitaire enseigne aux étudiants à soigner des patients inévitablement
stéréotypés par leur maladie ou, pire, par le type de soin qu’on dispense dans
le service où ils font un stage. Confrontés à des patients dont on ne leur
montre que les problèmes cardiaques ou les
problèmes neurologiques, les médecins en formation ne sont jamais en mesure de
voir les individus dans leur intégralité, ni d’apprendre à hiérarchiser leurs
difficultés. Quand un patient entre dans un service d’urologie, le problème
numéro un est un problème d’urologie, même si ce patient souffre d’une
dépression grave ou d’une artérite liée à sa consommation de tabac.
Et ce
qui fait toute la particularité – et la complexité – de la médecine générale
(ou des spécialités généralistes exercées en ville ou dans les hôpitaux de
région), c’est qu'on s'y s’occupe de tout le monde. Et qu'on ne trie pas les problèmes
à mesure qu’il surviennent.
6° La sélection des patients contribue aux inégalités
L’immense
majorité des médecins n’ont pas, lorsqu’ils entrent en faculté, envie de soigner
tout le monde. Ils ont leurs appétences – ce qui n’est pas scandaleux – mais
ils ont aussi, surtout, des répulsions. Ni les unes ni les autres ne sont
abordées, discutées, voire même abordées pendant leur formation. Elles restent niées
ou ignorées, même quand on les voit comme le nez au milieu de la figure. En
France, un étudiant en médecine raciste, sexiste, homophobe, méprisant avec les
pauvres ou avec les obèses n’est que rarement remis à sa place pendant ses
études, et il n’est jamais sanctionné.
Or, un médecin peut choisir, dans l’immense
majorité des cas, d’exercer la médecine qu’il veut. Non seulement sa spécialité -quand
il le peut (et plus il s'insère dans le "sérail" hospitalier, plus il lui est facile de la choisir), mais
aussi et surtout les conditions dans lesquelles il exerce : son lieu d'installation,
la nature des soin qu’il délivre, quel rythme de travail il préfère, s’il fera
des visites à domicile ou non ; tous ces choix lui permettent consciemment
ou non de sélectionner de manière
plus ou moins exclusive les patients qu’il recevra. (Certains vont même
jusqu’à l’ignominie consistant refuser les patients bénéficiaires de l’aide
sociale, par exemple.)
Que
ce soit bien clair : choisir d’être pédiatre pour soigner des enfants est
éminemment respectable. Refuser ses soins aux enfants des pauvres (ou des Roms,
ou des couples homosexuels, ou des musulmans) ne l’est pas. Dans le code de déontologie,
il est écrit qu’un médecin peut refuser de soigner un patient. Il n’est pas dit
qu’il a le droit de refuser les patients pour satisfaire ses préjugés de classe. C'est pourtant ce que beaucoup n'hésitent pas à faire.
La
manière dont un médecin use de ses privilèges découle inévitablement de ses
priorités et de ses phobies. Certains veulent, en « contrôlant » tous
les paramètres, se protéger, pour des raisons respectables : le jeune
généraliste qui ne reçoit que sur rendez-vous parce qu’il ne veut pas être
débordé, par exemple ; ou encore le praticien qui choisit de faire
exclusivement de l’homéopathie parce qu’il trouve l’exercice allopathique trop
intrusif et ses remèdes trop toxiques. D’autres voient leur métier beaucoup plus
comme une source de revenus que comme la délivrance d’un service au public. Alors
ils calibrent leur activité en fonction de ça.
Savoir,
prescription et connaissance du système permettent aux médecins de protéger
leur propre santé et celle de leurs proches. (Le fait que certains médecins se droguent
ou se suicident n’infirme pas ce privilège, en particulier quand il s’agit de
leur famille.)
Mais
la liberté de choisir sa patientèle, de décider qui on soigne et qui on ne
soigne pas, est un privilège proprement régalien. Il met le médecin qui en
dispose dans une situation de pouvoir insensée – comme en témoignent les
dépassements d’honoraires exorbitants que demandent certains spécialistes. Ici encore, le système est complice puisqu’il a longtemps permis
à des praticiens salariés du service public d’avoir une consultation privée…
Dans
cette sélection des patients, le savoir, le savoir-faire et l’expérience
occupent une place de choix. En France, lorsqu’un médecin très spécialisé est
doté d’un statut important (chef de service ou de département), il peut
contrôler non seulement l'enseignement qui y est délivré, mais aussi les gestes qui sont faits (ou non, comme l’IVG ou la
stérilisation, par exemple) sous sa responsabilité, ainsi que les "catégories" de
patients qui pourront (ou non) y séjourner. Cette sélection souvent occulte, mais réelle, interdit, de
fait, à beaucoup de patients qui en auraient besoin de recevoir des soins.
Elle contribue aux inégalités scandaleuses du système de santé, inégalités
parfois flagrantes d’un étage à l’autre d’un même hôpital : tous les chefs
de service ne disposent pas de la même considération de la part de
l’administration – et donc, des mêmes libertés ou restrictions.
7° Le « corps médical » est
un fantasme commode pour tout le monde
Pour
l’ensemble des citoyens, cela semble une évidence : la santé est (en
principe) financée par tous, elle doit (en principe) bénéficier à tous en
fonction des besoins de chacun. Mais dans les faits, il n’en est rien :
les classes sociales les plus aisées sont en meilleure santé ET ont accès aux soins
plus facilement que les classes défavorisées. (Il n’y a plus de lutte des
classes en France, mais il y a toujours des classes.)
Mais
aucune politique de santé en France ne s’est jamais souciée de former et de répartir
les médecins sur le territoire en
fonction des besoins réels de la population.
Pour
beaucoup de médecins, c'est une aubaine : alors même que leurs
revenus sont financés par la sécurité sociale - donc, par les citoyens - ils revendiquent haut et fort
leur « indépendance d’installation » et leur « liberté de prescription ».
Comme si leur exercice ne devait souffrir aucun contrôle, aucun encadrement,
n’être soumis à aucune directive. Comme s’ils revendiquaient non seulement d’être
des citoyens à part (ce qu’ils sont déjà) mais en plus de n’avoir aucune obligation à
l’égard des autres citoyens.
***
Même si elle n’a aucune réalité en raison de l’hétérogénéité de la
profession, la notion de « corps médical » constitué, cohérent,
agissant en synergie reste pour beaucoup un fantasme bien commode :
- Pour
certaines franges de la population, d’abord. Imaginer que le corps médical ne
fait qu’un, c’est se donner l’espoir qu’à eux tous, les médecins en savent et en
font suffisamment pour nous soulager de nos souffrances ; qu’ils sont
suffisamment honnêtes pour ne pas abuser de nous ; qu’ils sont
suffisamment généreux pour nous tendre la main quand nous en aurons besoin. Ils prêtent serment, non ?
Derrière
le corps médical, la plupart d’entre nous imaginent « La Médecine »,
cette entité tout aussi fantasmatique et magique qu’un dieu, qui finira par guérir
« le cancer » et nous éviter à tou.te.s une maladie d’Alzheimer. Comment
expliquer autrement que les campagnes de collecte de fonds remportent toujours
le même succès malgré la pauvreté des retombées concrètes dans la population
générale ?
Quand
on est toujours tombé sur des médecins qui se comportent en soignants (il y en
a, heureusement ! ), le fantasme de "corps médical" incite à minimiser (voire à nier complètement)
l’existence de ceux qui se comportent de manière inexcusable. « Puisque mon
médecin est un bon médecin, les mauvais doivent pas être si nombreux que
ça. »
Evidemment,
plus on est en bonne santé, moins on a de mauvaises surprises avec les
médecins. Et comme le niveau de santé est proportionnel au niveau de revenus… Penser que les bons soins qu’on reçoit personnellement
sont délivrés par tous les médecins à
toute la population, ça permet de ne
pas se préoccuper de ce que les autres vivent – ou de ne pas les croire quand
ils protestent, voire de dire que c'est probablement de leur faute s'ils ont été maltraités.
(
(
Et bien entendu l’inverse est tout aussi vrai : subir des médecins maltraitants, ça incite
furieusement à penser – à tort – qu’ils le sont tous.
Ce type de raccourci peut se comprendre. D’autant que souvent, lorsque des patients disent avoir été maltraités, beaucoup de professionnels ont tendance à ne pas les croire. Même des professionnels de bonne volonté. Et quand un autre médecin ne vous croit pas, ça renforce le fantasme de "corps médical" - puisqu'un médecin prend "toujours" la défense des autres médecins.
Ce type de raccourci peut se comprendre. D’autant que souvent, lorsque des patients disent avoir été maltraités, beaucoup de professionnels ont tendance à ne pas les croire. Même des professionnels de bonne volonté. Et quand un autre médecin ne vous croit pas, ça renforce le fantasme de "corps médical" - puisqu'un médecin prend "toujours" la défense des autres médecins.
- Les
pouvoirs publics, qu’ils cherchent à favoriser les médecins ou à améliorer la
délivrance équitable des soins, considèrent la profession médicale comme s’il
s’agissait d’un seul et même corps, composé de cellules toutes solidaires.
Alors que ses membres se comportent de manière hiérarchisée, verticale, inégalitaire.
Quelle que soit la réforme qu’un gouvernement de droite ou de gauche veuille
faire passer, il lui sera toujours plus facile de l’imposer aux membres de la
profession qui ont le moins d’influence et qui, souvent, bossent le plus, dans
les plus mauvaises conditions. Donc, dans tous les cas, ce sont toujours les
mêmes qui trinquent. (Je ne ferai à
personne l’insulte de préciser lesquels. Disons seulement qu’il y en a en ville
et à l’hôpital, et que le plus souvent, leurs noms vous sont inconnus.) Mettre
tous les médecins dans le même sac, ça permet de négocier exclusivement avec
les syndicats « représentatifs » - c’est à dire les plus
embourgeoisés, les plus attachés à leurs privilèges et donc les plus puissants.
Ce n’est pas aux médecins les plus insérés dans les entreprises rentables (gros
cabinets de radiologie et laboratoires de biologie, cliniques et hôpitaux
privés) qu’on va imposer des restrictions, mais à ceux qui pratiquent la
médecine en petits groupes ou de manière artisanale. Ceux-là, de toute manière,
ils ne pourront jamais faire la révolution : ils sont trop occupés à soigner les
patients au milieu desquels ils vivent et exercent.
- Pour
un certain nombre de professionnels, enfin : adhérer au concept de
« corps médical » - et à ses institutions les plus archaïques
(l’Ordre) ou les plus corporatistes (la majorité des syndicats) - permet,
selon que vous serez puissant ou
misérable, tantôt de conforter ses privilèges et les accroître, tantôt de
se poser en victime en se trompant d’adversaire.
Car
pour des praticiens surchargés et coincés entre une administration souvent
imbécile et des patients eux-mêmes pressurés par des conditions sociales
insupportables, il est facile de croire
que l’adversaire numéro un, c’est le
patient. Après tout, c’est lui qui envahit la salle d’attente, qui fait sonner
le téléphone, qui déverse ses trop-plaints dans le bureau, qui fait passer
l’empathie du médecin en surcharge, qui s'énerve et qui parfois menace (et une fois, c'est une fois de trop, on ne soigne pas pour se faire taper dessus). C’est le patient qui harcèle ! Les professionnels, eux, ne sont jamais maltraitants ! Le serment d'Hippocrate le leur interdit. Donc...
Quand
ils lisent sur les réseaux sociaux ou entendent à la télé que des patients en
ont marre d’être maltraités par certains de leurs confrères, beaucoup de
praticiens (pas spécialement maltraitants) prennent ça pour une agression
personnelle. En réagissant ainsi, sans s’en rendre compte, ils s’assimilent à ce
corps médical fantasmatique, par lequel ils aimeraient être traités comme un
égal et protégés. Et beaucoup de ces praticiens oublient que le paiement à
l’acte (inégalement rémunéré selon
qu’on est généraliste ou spécialiste) les enchaîne irrémédiablement ; que leur illusion
d’indépendance fait d'eux des concurrents et les empêche de travailler ensemble ; que les dogmes
indiscutés que leur ont assénés leurs enseignants guident leur mode
d’exercice ; que la pauvreté de la formation scientifique en faculté leur
a fermé l’esprit et que les attitudes hautaines de leurs pairs induisent
le même type d’attitude de leur part envers leurs patients et à rejeter ce que ces patients expriment, ce qu’ils ressentent, ce qu’ils savent, ce qu’ils décident de faire
de leur vie.
Ce
fantasme leur interdit de voir que les industriels et les marchands, eux, taillent
soigneusement leur marketing à la mesure exacte de chaque praticien, de ses
failles psychologiques, de ses biais cognitifs, de ses frustrations et de son
ignorance. Il leur interdit de comprendre que pour les marchands il est de
première importance que les médecins ne soient pas des professionnels du soin
mais des dealers.
Le
fantasme d’un « corps médical » protecteur permet enfin à certains de
se protéger des critiques – et de ne pas examiner de près les individus ou les
actes qui déclenchent ces critiques. De même que l’Eglise catholique fait le
silence autour des prêtres pédophiles, beaucoup de médecins préfèrent rejeter
les accusations de maltraitances (morale ou physique) adressées à certains
membres de leur « corps », voire à certains gestes. Et se replient derrière leurs institutions les moins progressistes (c'est un euphémisme).
Pour
trouver « normal » que certains suggèrent aux étudiants d’
« apprendre » l’examen gynécologique sur une patiente endormie et non
prévenue, il faut oublier complètement que les patients ne sont pas des objets
d’étude ou d’apprentissage. Et croire, donc, que la soif de savoir du corps médical
l’emporte sur le respect des patients.
Pour
trouver « normal » qu’un médecin porte des jugements sur l’aspect
physique, les choix de vie ou les décisions thérapeutiques des patients, il
faut oublier que l’opinion d’un médecin n’a pas à s’imposer à celle d’un autre
citoyen. Il faut donc, par conséquent, penser que les médecins ont une conscience
morale supérieure à celle de leurs concitoyens.
Pour
trouver « normal » qu’un médecin accepte ou refuse un patient en
fonction de son aspect, de son genre, de son niveau socio-économique, de sa
religion ou de ses possibilités d’expression, il faut oublier que la loi interdit
toute discrimination aux professionnels de santé… et que c’est écrit noir sur
blanc dans le code de déontologie. Il
faut être convaincu que les médecins ne sont pas concernés par la loi commune.
Ce
qui est pratique dans ce fantasme de corps médical, c’est qu’il peut servir à
conforter des médecins ayant des statuts radicalement différents.
Quand
on est au sommet de la pyramide, il est très confortable de jouir de ses
privilèges sans jamais s’interroger sur leur dimension morale ; alors, pourquoi
s’en priver ?
Quand
on tout en bas, il est très réconfortant de s’accrocher à ses privilèges élémentaires
et à « l’esprit de corps » qui fait de vous un individu à part afin
d’oublier à quel point on est manipulé, exploité et entravé.
Bref, on fume l'opium qu'on peut.
Bref, on fume l'opium qu'on peut.
8° Pour ne plus subir, il faut accepter de questionner les évidences
Il
n’y a pas de solutions simples à un problème (un système) aussi complexe que
celui-là. Bien heureux lorsqu’on arrive déjà à en entrevoir certains
mécanismes. Mais une des manières de ne pas subir un système, c’est de
questionner ses « évidences », de refuser de les prendre pour argent
comptant et de retourner à des questions élémentaires, pour trouver ses propres
réponses, individuelles ou collectives.
En
voici quelques-unes, que je me pose depuis longtemps. Elles m'ont permis de ne pas désespérer, parce que j'ai trouvé certaines réponses personnelles pour canaliser ma colère et ma frustration. Des réponses constructives. Mais elles n’épuisent pas le
sujet. A chacun d’ajouter ses questions à la liste – ou de la remplacer par une
autre. Et de trouver ses propres solutions. Voire de les mettre en commun, pourquoi pas ?
"Qu’est-ce
que soigner, exactement ? Qui doit définir le soin ? Les médecins ou
ceux qui le demandent et le reçoivent ?"
"Quand
on décide de faire un métier de soin, pour qui le fait-on ? Où se trouve
le juste milieu entre la réalisation personnelle et l’obligation morale – et
sociale – de de servir les autres ?"
"Comment mettre ses privilèges au service des autres afin de pouvoir se regarder dans la glace tous les matins ?
"Comment mettre ses privilèges au service des autres afin de pouvoir se regarder dans la glace tous les matins ?
"Peut-on
vraiment soigner en choisissant qui
on soigne ? Et si la réponse est non, un pays démocratique doit-il tolérer de
former des médecins dont le comportement est élitiste à l’égard des
citoyens ?"
"Le
paiement à l’acte est-il le meilleur moyen d’assurer une rémunération suffisante aux
médecins qui soignent ? Est-il acceptable que les revenus d’un médecin
augmentent avec sa capacité à choisir les patients qu’il reçoit – ou les
revenus des patients qui le choisissent ?"
"Le
savoir et le savoir-faire médicaux appartiennent-ils aux médecins ? Quelle
obligation morale – et sociale - ont-ils de les partager ?"
"A
qui appartient le système de santé d’un pays ? A une toute petite partie
de ceux qui y travaillent ou à l’ensemble de la population ?"
Marc Zaffran/Martin Winckler